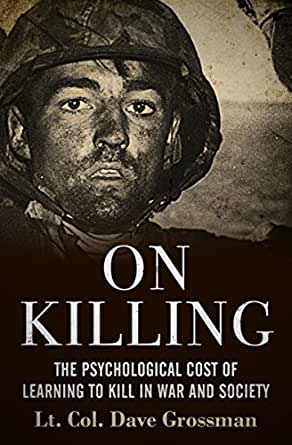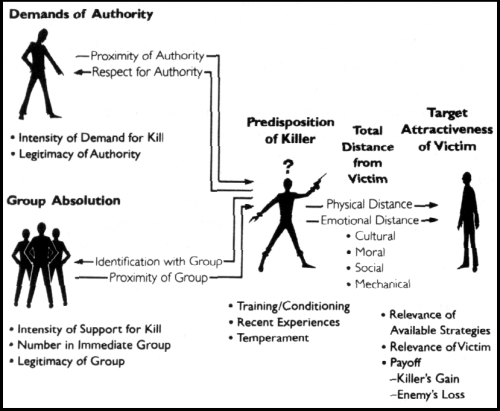I struggled with some demons
They were middle class and tame
I didn’t know I had permission to murder and to maim
S’il y a bien une chose que notre époque abhorre plus que tout, c’est la violence.
Dès le plus jeune âge, nos parents et nos éducateurs nous ont répété que « la violence ne résout jamais rien » et toute la société s’est jointe par la suite au chœur des non-violents.
Pour notre époque, le recours à la violence est pire qu’un échec, c’est une aberration.
Tout doit être désormais résolu par le dialogue, l’empathie et la compréhension mutuelle de nos différences.
Il s’agit là d’une immense erreur aussi bien sur le plan psychologique que politique.
Psychologiquement, il est capital d’admettre que la violence fait partie de la condition humaine.
Les rédacteurs de la Bible en avaient eu l’intuition en faisant de l’Humanité les descendants de Caïn, ce fils d’Adam et Eve qui tua par jalousie son frère, Abel, préféré par Dieu. De la même manière, la plupart des contes traditionnels comportent des éléments de grande violence, souvent expurgés dans leurs versions contemporaine, afin de préparer les enfants à la cruauté du monde. Plus proche de nous, le grand psychiatre Carl Jung expliqua qu’une personnalité parfaitement intégrée est celle qui est parvenue à accepter et à assimiler sa part « d’ombre », c’est-à-dire ce qu’il y a d’inférieur, de primitif et d’imparfait en nous. Si, terrifié par sa propre violence, l’être humain choisit de la nier et de la refouler, refusant, comme le chantait le poète, de se donner la « permission de meurtrir et de mutiler » alors il s’expose non seulement au risque de la névrose mais surtout à un retour aussi dévastateur qu’imprévisible de cette violence contenue.
Pour un individu comme pour la société à laquelle il appartient, tout l’enjeu consiste à accepter cette violence et de trouver des moyens de la canaliser, par exemple en la dirigeant contre les ennemis du groupe (guerre, rivalité), de la ritualiser à travers des compétitions sportives, des cérémonies religieuses ou de certains manifestations populaires (carnaval, corrida) ou encore de l’homéopathiser via le jeu ou la culture de la vanne que l’on retrouve particulièrement dans les groupes ou les activités essentiellement masculines.
Rien n’est plus dangereux et destructeur pour la psyché que de refuser cette part d’ombre et nier la puissance de cette vie intérieure qui possède ses exigences propres. C’est pourtant ce que font tous ceux qui cherchent à expurger tout conflit et toute confrontation de la société en se faisant les apôtres inconditionnels de la bienveillance et de la non-violence, comme ces antispécistes qui refusent jusqu’à tuer les moustiques.
Dépassant désormais le seul cas du trouble individuel, ce refus de la violence devient aujourd’hui un phénomène politique concernant l’ensemble de la société. Au-delà de l’authentique violence physique, psychologique ou verbale, la juste sanction, l’autorité et les hiérarchies sont désormais perçues comme des violences et à ce titre condamnées.
Ce que refusent de voir les apôtres de la non-violence, c’est que le refus de la violence contribue à rendre paradoxalement la société encore plus violente et injuste. Si un agresseur sait qu’il court le risque immédiat d’une riposte, il peut être découragé de passer à l’acte à condition que le menace soit perçue comme crédible. Il s’agit là du principe même de la dissuasion et c’est d’ailleurs pour cela qu’un grand nombre d’espèces animales ont vu l’évolution sélectionner des caractéristiques physiques et des comportements hautement dissuasifs. A l’inverse, si l’agresseur sait que sa victime a peu de chances de riposter, il peut être tenté de laisser libre cours à son agressivité. Ce n’est donc pas un hasard si les violences dites “gratuites” frappent aujourd’hui en priorité les membres de la société considérés comme les plus faibles : personnes âgées, SDF, femmes isolées…
Loin d’encourager la pitié ou la compassion, la faiblesse et la vulnérabilité encouragent le plus souvent l’agression.
Dans la plupart des sociétés, c’est habituellement l’État qui possède le monopole de la violence légitime via la justice, les forces armées et la police. Or, aujourd’hui, dans les sociétés occidentales, ces trois fonctions sont de plus en plus défaillantes, encourageant les citoyens soit à subir passivement la violence, soit à se faire justice eux-mêmes.
En réalité, en choisissant de nier la violence et en privant l’État de sa capacité à répondre à cette dernière par la violence légitime, notre société a fait le pire choix possible, d’autant plus que son hypocrisie sur le sujet est aussi totale que manifeste.
Alors que la société refuse de punir sévèrement la violence, celle-ci ne cesse d’augmenter et se porte désormais sur les symboles de l’État et de son autorité comme la police et les pompiers. Ne pouvant que constater l’impunité dont ils jouissent, les criminels remontent alors la chaîne alimentaire et cherchent à découvrir jusqu’où ils peuvent imposer leur dominance.
Alors que la société prétend pacifier les rapports sociaux une violence économique et sociale sans précédent fait rage: licenciements, précarité, exploitation mais aussi mépris de classe et dédain des élites pour le peuple, ces ploucs qui » fument des clopes et roulent au diesel ». Comme je l’ai expliqué dans un article sur le gaslighting politique, rien n’est plus violent et destructeur pour le psychisme que la négation d’un antagonisme infligeant une souffrance bien réelle.
Enfin, alors que notre société traque et condamne toutes les formes de « micro-agression » au point où même les humoristes et les caricaturistes ne peuvent plus exercer librement leur métier, la violence au quotidien augmente et se manifeste par une exaspération générale, une agressivité latente et une hausse spectaculaire des incivilités.
Autrefois, la violence était gérée de façon à se déverser de façon puissante et contrôlée dans les institutions et les occasions prévues à cet effet. Aujourd’hui, bloquée dans son écoulement « naturel », elle suinte à travers une multitude de petits ruisseaux qui viennent irriguer l’ensemble de la vie publique. Peu à peu, une logique perverse se met en place dans l’esprit de ceux qui subissent la violence sans pouvoir riposter : ils attendent de tomber sur plus faible qu’eux ou sur une espèce « non protégée » pour pouvoir enfin se libérer de cette violence contenue. C’est ainsi que durant les manifestations de décembre 2018, certains membres des forces de l’ordre et du gouvernement ont infligé aux Gilets Jaunes une violence qu’ils ne peuvent plus faire subir aux criminels et aux délinquants des quartiers. Comme nous l’a enseigné René Girard, la société doit toujours se décharger de sa violence sur un bouc émissaire. Aujourd’hui, le bouc émissaire que l’on sacrifie sur l’autel de la non-violence, c’est le peuple.
Si le peuple constitue la première victime, l’homme en est la deuxième.
En effet, le refus de la violence va souvent de pair avec la dénonciation d’une masculinité qui ne peut plus désormais être que toxique. Si l’homme est souvent celui par qui la violence arrive, il ne faut pas oublier qu’il est aussi souvent celui qui y met un terme. Ceux qui se complaisent dans la dénonciation de la “violence patriarcale” sont souvent les premiers à se précipiter vers un policier, un pompier ou un militaire pour les protéger de ceux qui n’ont, eux, aucun scrupule à infliger une violence bien réelle. Notons enfin que tous les hommes ne sont pas égaux devant la dénonciation de la violence masculine : autant la violence émanant de l’homme blanc, désormais responsable de tous les crimes, y compris ceux d’éventuels ancêtres, est vigoureusement condamnée, autant celle venant de l’Étranger est souvent excusée au nom du traumatisme colonial, de la différence culturelle ou de la non-maîtrise des codes culturels.
Dans tous les cas, le refus d’une réalité psychologique et sociale aussi fondamentale que la violence ne peut que conduire notre société et ses citoyens à la névrose et se terminer soit par une forme de suicide collectif, la victime s’abandonnant à la hache du bourreau, soit à un retour aussi spectaculaire que destructeur de cette violence refoulée.
Socialement et politiquement, la voie de la guérison serait que l’État et la société assument à nouveau pleinement leur monopole de la violence légitime et retrouvent un sens de la justice et du châtiment plus proche de Charles Martel et des Croisades que de l’ONU et des Droits de l’Homme mais les hommes du XXIème siècle n’ont pas encore manifestement assez souffert pour en revenir à de telles évidences et quand bien même le voudraient-ils en auraient-ils encore la force ?
A l’échelle individuelle, le salut passe par l’acceptation de sa part d’ombre, la pratique d’activités permettant d’exprimer et de canaliser cette violence (sports de combat, compétitions, jeux de rôle) et surtout le fait de ne jamais se laisser enfermer dans le statut de victime en cas d’agression. Mieux vaut être considéré, même à tort, comme une brute ou un fasciste que de finir névrosé et soumis.
Pour aller plus loin:
On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society