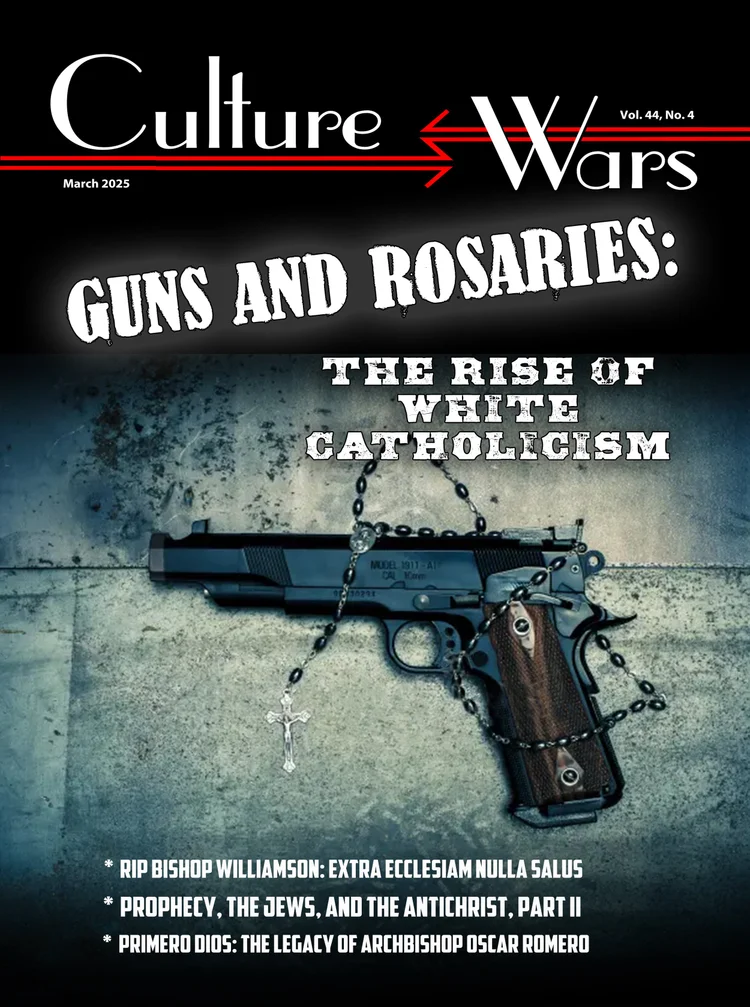Extraits de l’article de Lucie Levine publié le 01/04/2020 sous le titre original « Was Modern Art really a CIA psy-op ? ». Traduit de l’anglais par Stanislas Berton.
Durant la deuxième moitié du vingtième siècle, l’art et le design modernes devinrent les symboles du libéralisme, de l’individualisme, du dynamisme et de la prise de risque créative rendue possible par une société libre, le style de Jackson Pollock offrant un contrepoint à l’oppression nazie ou soviétique. Ainsi, l’art moderne devint une arme utilisée pendant la Guerre froide. Aussi bien le Département d’État [NdT : le ministère des affaires étrangères américain] que la CIA apportèrent leur soutien à des expositions d’art américain dans le monde entier.
[…]
Les liens entre l’art moderne et la diplomatie américaine furent établis durant la Seconde Guerre mondiale quand le musée d’art moderne (MoMA) fut mis au service de l’effort de guerre. Le MoMA fut fondé en 1929 par Aldrich Rockefeller. Dix ans plus tard, son fils Nelson Rockefeller devint le président du musée. En 1940, alors qu’il était encore président du MoMA, Rockefeller fut nommé par l’administration Roosevelt coordinateur des affaires inter-américaines. Il occupa également le poste d’assistant aux ministères des affaires étrangères pour l’Amérique Latine.
[…]
Dans le combat pour gagner « les coeurs et les esprits », l’art moderne se révéla particulièrement efficace. John Hay Whitney, président du MoMA et membre de la famille Whitney qui fonda le Whitney Museum of American Art,expliqua que l’art jouait un rôle important dans la défense nationale car il avait « la capacité d’éduquer, d’inspirer et d’affermir les cœurs et les volontés des hommes libres. »
Whitney succéda à Rockefeller en tant que président du MoMA en 1941 afin de permettre à Nelson de consacrer toute son attention à ses activités de coordinateur. Sous Whitney, le MoMA devint un « élément de défense nationale ». Selon un communiqué de presse du musée daté du 28 février 1941, le MoMA allait « inaugurer un nouveau programme pour accélérer les échanges artistiques et culturels dans cet hémisphère au sein des vingt et une républiques qui le composent. » L’objectif était le « Pan-Américanisme ». Une « caravane artistique » traversant l’Amérique Latine « contribuerait davantage au développement de notre amitié que dix ans de relations commerciales ou politiques. »
Une fois la guerre terminée, Nelson Rockefeller retourna au musée et les membres de son équipe des affaires inter-américaines prirent la direction du programme international des expositions du MoMA : René d’Harnoncourt, qui dirigeait le département artistique des affaires inter-américaines devint le vice-président du musée chargé des activités extérieures. L’ancien membre de l’équipe, Porter Mc Cray, devint le directeur du programme international du musée.
Les liens entre l’art moderne et la politique américaine de Guerre froide étaient si étroits qu’en 1951 Mc Cray prit un congé sans solde pour travailler sur le plan Marshall. En 1957, Whitney démissionna de son poste de de président du conseil d’administration du MoMA pour devenir l’ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne. Bien qu’ambassadeur, Whitney demeura un administrateur du musée et son successeur en tant que président fut Nelson Rockefeller qui avait occupé jusqu’en 1955 le poste d’assistant spécial aux affaires étrangères pour le président Eisenhower.
Malgré ces liens entre l’art moderne et la diplomatie américaine, la propagande soviétique affirmait que les États-Unis étaient « un désert capitaliste vierge de toute culture ». Afin de mettre en avant le dynamisme culturel des États-Unis, en 1946, le Département d’État dépensa 49 000 dollars [NdT :environ 800 000 euros] pour acheter soixante-dix neuf tableaux peints par des artistes modernes américains et les intégra dans une exposition itinérante baptisée « “Advancing American Art.”
[…]
Les craintes du grand public américain concernant le « péril rouge » conduisirent à un retour anticipé de l’exposition mais c’est justement parce que l’art moderne ne jouissait pas d’une popularité universelle et qu’il était créé par des artistes rejetant ouvertement l’orthodoxie qu’il s’agissait d’une vitrine parfaite pour montrer au monde extérieur les fruits de la liberté culturelle américaine. À titre personnel, le président Truman considérait l’art moderne comme « les élucubrations foireuses de feignants fumeux ». Pour autant, il ne qualifia pas cet art de dégénéré et n’envoya pas les artistes dans un goulag en Sibérie. Par ailleurs, l’impressionnisme abstrait constituait une réfutation directe du réalisme socialiste soviétique. Nelson Rockefeller aimait l’appeler « la peinture de la libre entreprise ».
En opposition avec le « Front Populaire » soviétique, le magazine « New Yorker » présenta avec beaucoup d’à propos le rôle politique joué par le modernisme américain comme « le front impopulaire ». L’existence même de l’art moderne prouvait au monde que ses créateurs étaient libres de créer, peu importe que vous appréciez ou non leur art.
Si l’exposition « Advancing American Art » apporta la preuve que les artistes américains étaient libres parce qu’ils pouvaient étaler autant de peinture qu’ils le voulaient, preuve fut également faite que le Congrès n’était pas toujours prêt à dépenser les dollars des contribuables pour financer cette initiative. […] De toute évidence, le Département d’État n’était pas le bon mécène pour l’art moderne, ce qui nous conduit à la CIA.
En 1947, au moment même où l’ exposition« Advancing American Art » était rappelée au pays […], la CIA était créée. Le berceau de la CIA fut le bureau de « Wild » Bill Donovan du Bureau des Services Stratégiques (OSS), c’est à dire le renseignement militaire américain durant la guerre. John Hay Whitney et Thomas W. Braden du MoMA avaient tous les deux fait partie de l’OSS.
Parmi les anciens agents de l’OSS, on comptait le poète Archibald MacLeish, l’historien et intellectuel Arthur M. Schlesinger Jr et le réalisateur John Ford. Au moment de la création officielle de la CIA, les opérations clandestines étaient depuis longtemps le terrain de jeu de l’élite culturelle. Dès lors que des employés de musée comme Braden furent recrutés, l’intelligentsia culturelle et la CIA se retrouvèrent à combattre côte à côte durant la Guerre froide, avec la fondation Whitney agissant comme un circuit de financement.
En parlant de couverture, en 1957 le MoMA récupéra (du Département d’État), le pavillon américain de la biennale de Venise afin que les États-Unis puissent continuer à exposer de l’art moderne à l’étranger sans utiliser des fonds publics. (Le MoMA géra le pavillon américain à Venise de 1954 à 1962. Ce fut le seul pavillon national détenu par une organisation privée.)
[…]
La CIA ne se contenta pas de financier les expositions internationales du MoMA, elle fit également des incursions culturelles en Europe. En 1950, l’Agence créa le Congrès pour la Liberté Culturelle (CCF) dont le siège fut installé à Paris. Présentée officiellement comme une « association autonome de musiciens et d’écrivains », il s’agissait en réalité d’un projet financé par la CIA pour « propager les vertus de la culture démocratique occidentale ». Le CCF opéra pendant dix-sept ans et, à son apogée, « avait des bureaux dans trente-cinq pays, employait des dizaines de personnes, publiait dans plus de vingt magazines prestigieux, montait des expositions, possédait un service d’information, organisait des conférences internationales et récompensait les artistes avec des prix et des spectacles publics. »
La CIA avait choisi d’installer le siège du CCF à Paris car la ville avait été pendant longtemps la capitale de la vie culturelle européenne et le but principal du CCF était de convaincre les intellectuels européens- susceptibles de succomber à la propagande soviétique qui suggérait que les États-Unis étaient peuplés de capitalistes philistins-que c’était en réalité le contraire : avec une Europe affaiblie par la guerre, il revenait désormais aux États-Unis de protéger et de soutenir la tradition culturelle occidentale face à aux dogmes soviétiques.
[…]
En conséquence, la CIA finança la Partisan Review, qui était la revue phare de la gauche américaine non-communiste et dont le prestige, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, était immense grâce à son association avec des écrivains comme T.S Eliot et George Orwell. Sans surprise, le rédacteur en chef de la Partisan Review était le critique d’art Clément Greenberg, un arbitre des élégances très influent et le plus grand défenseur de l’expressionnisme abstrait dans le New-York d’après-guerre.
[…]
Notes du traducteur :
Cet article nous permet de mieux comprendre :
1)l’influence des grandes dynasties mondialistes (Rockefeller) sur la culture, les services de renseignement, la diplomatie et la politique et la circulation de leurs membres ou associés entre ces différents domaines. Nous voyons également comment cette influence permet de façonner les tendances culturelles, les goûts du public mais aussi d’agir indirectement dans le cadre d’affrontements géopolitiques. À noter que la même stratégie, portée par les mêmes acteurs, fut utilisée pour imposer la « libération sexuelle » et la « médecine allopathique » aux populations occidentales.
2) l’utilisation de l’art par la CIA et le gouvernement américain comme vecteurs d’influence et instruments de soft-power, outils d’autant plus efficaces lorsqu’ils sont utilisés dans une logique d’opposition entre « blocs » apparemment rivaux. Comme l’ont compris les Russes et les Chinois, la souveraineté politique est indissociable de la souveraineté culturelle et sa protection doit être considérée comme faisant partie intégrante de la défense nationale.
3) l’objectif de Satan est de détruire tout ce qui est Beau, Vrai et Bon. Cela inclut la peinture figurative qui s’efforce de représenter le plus fidèlement possible la beauté de la Création ainsi que celle de l’Homme que Dieu a conçu à Son image.
Pour aller plus loin :
Essais de Miles Mathis sur l’art
Aude de Kerros, L’Imposture de l’Art contemporain.
Christine Sourgins, Les mirages de l’art contemporain
Promotion de la “libération sexuelle” par les réseaux mondialistes